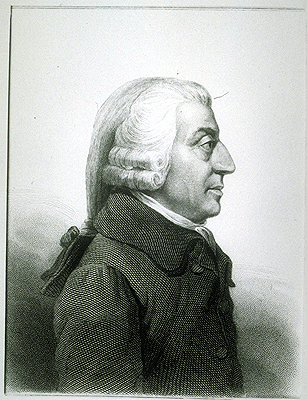 Avant de discuter des théories, il est préférable de s’accorder sur le cadre général dans lequel elles s’inscrivent. C’est le cas de la physique quantique, qui est une théorie-cadre, dans laquelle peuvent se développer des théories plus particulières comme l’interaction entre la matière et le rayonnement ou encore la chimie. C’est également le cas de la philosophie, qui expose tout d’abord une « theoria », c’est-à-dire une représentation du monde (le cosmos pour les stoïciens, l’amour pour les chrétien, le chaos pour Nietzsche) dans laquelle peut se déployer une morale. Il en va de l’économie comme de la physique ou de la philosophie, l’objet de cet article est donc de préciser quelle est ma représentation globale de l’économie, la matrice à partir de laquelle examiner l’ensemble des théories économiques.
Avant de discuter des théories, il est préférable de s’accorder sur le cadre général dans lequel elles s’inscrivent. C’est le cas de la physique quantique, qui est une théorie-cadre, dans laquelle peuvent se développer des théories plus particulières comme l’interaction entre la matière et le rayonnement ou encore la chimie. C’est également le cas de la philosophie, qui expose tout d’abord une « theoria », c’est-à-dire une représentation du monde (le cosmos pour les stoïciens, l’amour pour les chrétien, le chaos pour Nietzsche) dans laquelle peut se déployer une morale. Il en va de l’économie comme de la physique ou de la philosophie, l’objet de cet article est donc de préciser quelle est ma représentation globale de l’économie, la matrice à partir de laquelle examiner l’ensemble des théories économiques.Pour être générale, cette théorie doit faire abstraction des systèmes économiques, c’est-à-dire qu’elle doit être également valide dans le cadre du capitalisme que du communisme, du libéralisme comme du totalitarisme ou de l’esclavagisme, du troc comme de l’échange par la monnaie. En effet, il y a bien eu une économie en URSS comme il y en a eu une sous le régime nazi qui, bien qu’étant basées sur des principes complètement antagonistes, s’inscrivaient dans le même cadre général que l’économie de marché. Une autre condition de la généralité est de restreindre au maximum le nombre de concept nécessaire pour décrire la réalité. Pour reprendre l’exemple de l’électrodynamique quantique, elle permet d’expliquer tous les phénomènes physiques et chimiques à l’exception de la gravitation et de ce qui se passe dans le noyau des atomes à partir seulement de trois briques élémentaires : le déplacement d’un photon d’un point à un autre, le déplacement d’un électron d’un point à un autre et l’interaction entre un photon et un électron (obsoprtion ou émission).
Pour l’économie, cinq briques élémentaires sont selon moi nécessaire, ou plutôt quatre plus l’être humain qui est l’origine et la finalité de toute action économique. On peut donc reprendre la célèbre phrase de Protagoras en ce qui concerne l’économie « l’Homme est la mesure de toute chose ». En plus de l’homme, il faut ajouter les concepts de capital, de ressource, de biens (ou de service) et d’utilité. Ces cinq briques essentielles de l’économie forment un cycle représenté schématiquement ci-dessous :

1. Définitions des principaux concepts
Commençons par définir les termes. L’Homme ne pose pas de problème, si ce n’est le politiquement correct qui devrait m’inciter à utiliser les termes « Etre humain » ou « Individus » et que je vais choisir ici d’ignorer tant pour des raisons pratiques qu’idéologiques. L’Homme est le constituant élémentaire de la société dans laquelle va s’opérer les échanges qui caractérisent l’économie.
Le Capital a ici un sens très général, ce n’est pas simplement l’opposition au travail comme dans la théorie marxiste. J’appelle Capital tout ce qui est productif, c’est-à-dire ce qui est à la base du processus de production mais qui ne disparaît pas dans ce processus, même s’il peut s’user. Cette notion recouvre bien évidemment l’ensemble des machines, les lopins de terre ou encore les mines. Mais il faut y ajouter l’être humain en tant que force de travail, d’animal laborans. Ce capital humain se décompose en un capital physique (substituable à la machine) et à un capital intellectuel.
La principale caractéristique du Capital est de fournir des Ressources productives. A la différence du capital, la ressource disparaît au cours du processus de production, c’est le carburant de l’économie. Reprenons les différents types de capitaux pour voir à quelles ressources ils correspondent. Pour les machines, il s’agit de leur utilisation pendant une période donnée, par exemple, la ressource d’un marteau c’est sa capacité à enfoncer des clous. Pour les mines, il s’agit bien évidemment des matières premières (minerai, pétrole, gaz,…) qui y sont extraites pendant une période donnée. Pour la terre, il s’agit de la récolte, par exemple la moisson de blé. Vient alors une question intéressante : un sac de blé, est-ce du Capital ou une Ressource ? Tout dépend en fait de l’usage que l’on en fait : si on l’utilise comme semence pour l’année suivante, c’est du capital, si on l’utilise pour produire de la farine, c’est évidemment une ressource. Enfin, le Capital humain a pour ressource le travail, qu’il soit manuel ou intellectuel. A travers tous ces exemples, on voit bien qu’alors que le Capital peut être évalué de manière ponctuelle, les Ressources n’ont de sens que sur une certaine période.
Les Biens (ou les services) sont le résultat du processus de production, ils sont formés à partir des ressources utilisées et, généralement, ont une valeur supérieure à la somme de ces ressources, c’est lors de cette étape de l’économie que l’on peut parler de valeur ajoutée. Ces biens sont soit consommés, soit épargnés pour venir augmenter le stock de Capital. Ce qui distingue principalement les biens et les services, c’est la nature des ressources qu’ils emploient : alors qu’un bien nécessite des matières premières, des machines et du travail, un service requiert principalement du travail.
L’Utilité est le résultat du processus de consommation pour les individus. C’est une notion essentiellement subjective, qui recouvre à la fois les besoins et les plaisirs de chacun. Cette utilité ne doit pas être confondue avec le bonheur puisqu’elle ne tient compte que de la satisfaction apportée par les biens et les services produits par l’économie. Chaque discipline doit savoir trouver ses limites, pour l’économie, il s’agit précisément de s’arrêter à la notion d’utilité et de ne pas se laisser entraîner par l’idée de bonheur. C’est pour cela qu’aucune politique ne saurait se réduire à des considérations économiques. De par sa subjectivité, la notion d’Utilité est plus difficile à définir et surtout à représenter, en particulier on peut s’interroger sur son caractère absolu ou essentiellement relatif (utilité cardinale ou ordinale).
2. Relations entre ces différents concepts
Après les avoir définis, il s’agit désormais d’esquisser les principales relations qu’entretiennent ces cinq concepts les uns avec les autres. Si l’on reprend le schéma ci-dessus, cela revient à expliciter chacune des flèches.
La relation Homme – Capital
Cette relation est la question essentielle du système économique et du régime politique dans lequel s’inscrit l’économie. Dans le système capitaliste, cette relation repose sur la propriété : chaque individu possède un certain nombre de capitaux : des machines, des outils et bien entendu des forces de travail. Dans un monde libre, chaque Homme est propriétaire de sa propre force de travail et uniquement de celle-ci, contrairement à ce qui se passe sous le régime de l’esclavage. Dans un régime communiste et centralisateur, c’est l’Etat qui possède tous les capitaux et qui les assigne aux différentes individus, la relation n’est donc plus directe mais indirecte. Notons d’ailleurs que même dans les démocraties libérales, un grand nombre de capitaux sont publics c’est-à-dire également possédés par l’Etat. On pourrait également imaginer d’autres systèmes d’organisation, comme l’anarchie où les capitaux n’appartiennent à personne ou encore une organisation pré-sociale où s’appliquerait à tout moment la loi du plus fort. Une autre question fondamentale à propos de cette relation concerne la transmission des capitaux. En effet, si le Capital humain disparaît en même temps que celui à qui il appartient, il n’en va pas de même pour les machines ou les mines. On peut imaginer un système où les biens d’une personne décédée sont donnés à l’Etat qui les redistribue ensuite à toute la population, ou bien qu’ils deviennent la propriété de ses enfants, de sa veuve ou encore d’une personne de son choix. C’est donc au sein de cette relation entre l’Homme et le Capital que s’établissent les grands choix politiques et en particulier la question de la propriété et celle de la succession.
La relation Capital – Ressources
La distinction entre le Capital (qui est un stock) et les Ressources (qui sont un flux) est l’élément essentiel de cette « théoria » économique que j’essaye de construire. La société a en effet tout à gagner à ce que ceux qui possèdent les capitaux les utilisent au maximum de leurs possibilités. Une machine inutilisée au fond d’un garage, un château qui tombe dans l’abandon : voilà des pertes irréversibles pour l’économie. C’est la raison pour laquelle la fiscalité sur le capital est importante : d’un point de vue strictement économique, une personne qui possède un capital dont elle n’arrive pas à assumer l’entretien et l’utilisation doit le céder à ceux qui en ont les moyens. Si l’on s’intéresse maintenant au Capital humain, on est amené à inverser la relation habituellement supposée entre développement économique et chômage. L’idée couramment avancée (et qui est juste à court terme) est que la conjoncture économique détermine l’emploi et donc le chômage. On parle souvent du taux de croissance minimal d’une économie en-dessous duquel on détruit des emplois. En réalité, dans un raisonnement à plus long terme, il faut inverser la causalité pour dire que le chômage se traduit par une sous utilisation et une plus forte dépréciation du Capital humain ce qui limite donc le développement économique. Le « bon capitaliste », d’après ce que je viens d’esquisser, ce n’est pas celui qui possède que ce qui lui est utile mais celui qui permet de tirer le plus de ressources du Capital qu’il possède.
La relation Ressources – Biens
Cette relation recouvre la quasi-totalité du processus productif : il s’agit de l’utilisation des ressources mise à disposition par les Capitalistes pour produire les biens de consommation et d’investissement. Le lieu de cette relation, c’est l’entreprise privée (dans un régime capitaliste) ou la manufacture nationale (dans un régime communiste). Très souvent, cette relation entre les Ressources et les Biens n’est pas directe, elle est intermédiée : on trouve ainsi des agences pour l’emploi qui mettent en relation les travailleurs avec les entrepreneurs ou les banques qui mettent en relation les détenteurs de capitaux avec les entrepreneurs. Cette étape du processus économique, où les Ressources sont transformées en Biens, est essentielle puisque c’est là que se forme toute la richesse de l’économie, c’est-à-dire toute la valeur ajoutée. Pour évaluer la performance d’une économie, on ne s’intéresse d’ailleurs qu’à cette relation en calculant la somme de toutes les valeurs ajoutées de toutes les entreprises pour aboutir au Produit Intérieur Brut. Comment répartir cette richesse créée dans les entreprises ? Il est convenu que cette valeur ajoutée doit se répartir entre le Travail, le Capital et les impôts payés à l’Etat. Dans le cadre proposé dans cet article, cette répartition prend tout son sens : seuls les Capitalistes sont rémunérés, selon la productivité de leurs capitaux. Il n’y a donc pas de différence fondamentale entre l’actionnaire qui réclame son dividende en échange du prêt de ses capitaux-machines, le travailleur qui réclame son salaire en échange de l’utilisation de son capital-humain ou de l’Etat qui réclame des impôts en échange de l’utilisation de biens et de services publics (infrastructure, police, justice, éducation…).
La relation Biens – Capital et la dépréciation du Capital
Comme on l’a déjà indiqué, le Capital est un stock, entre deux périodes il peut donc être diminué ou bien être augmenté. La diminution, c’est ce que l’on appelle la dépréciation du Capital, ce qui correspond généralement à son usure. La machine s’abîme quand on l’utilise, la mine se vide quand on l’exploite, le travailleur se fatigue physiquement et oublie des choses qu’on lui avait enseignées. Il y a donc un risque qu’année après année, le stock de Capital s’amenuise et qu’au bout d’un certain temps aucune activité économique ne soit plus possible (même si certains lecteurs attentifs de ce blog m’objecteront qu’une suite positive décroissante ne tend pas forcément vers zéro !). Pour augmenter le stock de Capital, il faut donc utiliser une partie de la richesse ou de la valeur ajoutée obtenue par la création de Biens pour le renouveler. C’est ce que j’appelle l’épargne ou l’investissement, qui sont dans ma bouche parfaitement synonyme l’un de l’autre. Un bien épargné c’est un bien qui n’a pas vocation à être consommé mais à être investi pour augmenter le stock de Capital. On peut ainsi épargner du travail ou de l’utilisation de machines pour construire d’autres machines, de même on peut épargner du travail pour se former et augmenter ainsi son Capital humain. Entre l’artisan qui construit un outil et le futur travailleur qui étudie, il n’y a donc pas de véritable différence : il s’agit de travailler aujourd’hui pour une activité pas immédiatement productive mais qui augmentera sa productivité à l’avenir. C’est donc l’épargne ou l’investissement qui fait intervenir l’idée de temps dans l’économie et plus particulièrement la notion de calcul intertemporel. Quelle préférence faut-il accorder au présent sur l’avenir et comment la société peut-elle inciter les individus à épargner pour assurer la prospérité future ? Cette réflexion nous conduit inévitablement à la notion de taux d’intérêt qui sert grosso modo à rémunérer le temps que l’artisan a sacrifié pour fabriquer son outil quand il décide de le prêter. Pour le travailleur, l’incitation à se former ne vient pas du taux d’intérêt mais de l’espoir de toucher un meilleur salaire s’il fait de plus longues études. Là encore, intérêt, salaire, impôt, tout ceci n’a qu’un seul nom : rémunération du capital.
La relation Biens – Utilité
Cette relation porte un nom très simple : c’est la consommation. On peut d’ailleurs envisager cette relation dans les deux sens : les individus retirent de l’utilité des biens qu’ils consomment ou les entreprises produisent les biens qui procurent de l’utilité. Tout dépend qui si l’on prend le point de vue de l’offre ou celui de la demande. Il faut avoir à l’esprit que l’augmentation de l’Utilité des consommateurs est la raison d’être de toute l’économie : la propriété, le travail, l’investissement n’en sont que des moyens. Citons à ce propos cette réplique amusante d’un économiste américain à propos du plan de relance de Barack Obama « On nous annonce que ce plan va relancer la croissance et faire baisser le chômage, c’est une bonne nouvelle, même si cela aurait été encore mieux qu’il relance la croissance sans augmenter le travail ! ». La consommation repose sur deux intermédiaires principaux : la distribution et le marketing. Idéalement, ces intermédiaires sont un système de logistique et d’information qui met en relation des consommateurs qui ont des envies avec des entreprises qui ont des produits. Plus souvent, ils consistent à vendre de gré ou de force aux acheteurs ce qui a été produit.
La relation Utilité – Homme
C’est la partie un peu philosophique de l’économie, qui consiste à se demander « A quoi bon ? ». Pourquoi vouloir à tout prix augmenter son utilité, ses plaisirs ? Cela nous rend-il plus heureux ? La réponse la plus sage que l’économie puisse faire à ces questions est précisément de ne pas chercher à y répondre et de laisser cette réflexion fondamentale à la philosophie, à l’art et à la politique, qui semble beaucoup mieux placés pour y répondre. L’économiste, comme le scientifique, doit davantage se focaliser sur la question du comment que sur celle du pourquoi.
3. Questions en suspens et Conclusion
Plusieurs questions mériteraient (et mériteront certainement dans les semaines à venir) d’être traitées à travers cette représentation de l’économie. Tout d’abord, quel est le rôle de la monnaie dans l’économie, quelle est son influence sur chacune des relations explicitées au cours de cet article ? Ensuite, comment valoriser les Capitaux ? Théoriquement, la valorisation d’un Capital doit être la somme actualisée des revenus futurs que ses ressources permettent de produire. Cette valeur se rapproche de ce que Marx appelle la valeur d’usage, valeur que le marché est sensé refléter à tout instant. Comment se fait-il que la valeur d’usage et la valeur de marché puissent différer (bulles financières) ? Enfin, quelle place accorder au prêt et au crédit dans cette représentation de l’économie ?
S’il fallait résumer la résumer en un minimum de mots, je dirais que « l’économie, c’est de la compatibilité et de la morale ». Par comptabilité j’entends une prise en compte de la réalité matérielle du processus de production (on ne peut pas utiliser plus de ressources qu’il n’y en a de créées, on ne peut pas emprunter plus de biens qu’il n’y en a de prêtés…) et par morale j’entends une organisation collective tacitement acceptée par l’ensemble de la société. On a bien vu en effet que toute l’économie repose au départ sur un choix politique qui est celui de la relation entre l’Homme et le Capital. C’est parce que l’esclavage était moralement inacceptable qu’il a été abandonné, de même que l’expropriation de masse par l’Etat. Un système économique ne peut donc persister que s’il est jugé légitime.
L’économie, c’est donc à la fois les marchés et la politique, les premiers apportant l’efficacité quand le second apporte le consensus social. A l’heure où le capitalisme est considéré comme le pire de tous les maux, je reprendrais donc à mon compte cette citation d’Henri Guaino : « le capitalisme est essentiellement moral ».


