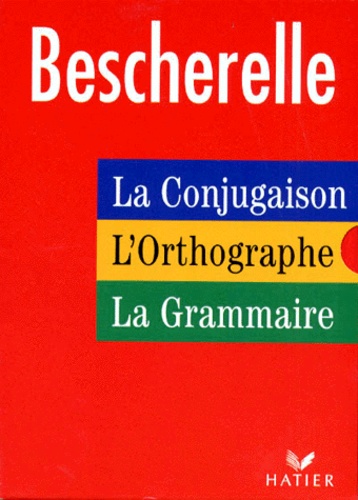Après avoir brièvement évoqué le sujet lors de mon dernier billet d'humeur, j'ai bien compris que je n'étais pas allé suffisamment au fond du sujet sur la réforme des retraites. Mon opinion demeure inchangée : cette réforme est une bonne réforme, certainement la meilleure chose qui ait été faite durant ce quinquennat. Cet article a pour tâche d'étayer cette opinion. Il s'articulera autour de trois questions structurantes : en quoi une réforme du système des retraites est-elle indispensable ? Pourquoi toucher aux bornes d'âge et pas seulement à la durée de cotisation ? Cette réforme est-elle juste ?
En quoi une réforme du système des retraites est-elle indispensable ?
C'est le point central du débat, sur lequel beaucoup de personnes sensées (y compris des syndicats et des partis politiques d'opposition) se rejoignent. C'est en même temps un point contesté par certains opposants à la réforme puisqu'elle ne figurait pas dans le programme du candidat Sarkozy en 2007 et qu'elle serait donc entachée d'illégitimité.
Reprenons à la base : un système de retraite est un régime qui donne des droits (les pensions) en même temps qu'il impose des devoirs (les cotisations). Le déséquilibre financier des retraites, qui s'est fortement accentué suite à la crise économique, car moins de cotisations ont été versées, est le signe d'un excès des droits sur les devoirs. Pour le dire autrement : le régime des retraites français offre des prestations qu'il n'a pas les moyens de verser. Pour compenser cet excès des droits sur les devoirs, on a recours à l'endettement (1 retraite sur 10 financée par l'emprunt à l'heure actuelle). J'aimerais insister sur le caractère inacceptable, s'il était amené à perdurer, d'un tel déséquilibre : on passe d'un système où les individus payaient des cotisations pendant leur vie active pour toucher des pensions une fois à la retraite, à un système où les générations actives devront payer des cotisations mais également des impôts pour rembourser la dette laissée par les générations précédentes, tout cela sans certitude de toucher une pension une fois à la retraite.
On ne le dira donc jamais assez : réformer les retraites est un impératif moral en plus d'être un impératif économique et social. Beaucoup de personnes s'accordent sur ce point, mais tout dépend ce que l'on met derrière le mot « réforme . La réponse est très simple : toute modification du régime des retraites qui permet de réduire l'excès des droits sur les devoirs. On peut envisager plusieurs solutions : on peut réduire les droits (diminuer les pensions, augmenter l'âge à partir duquel on a le droit de toucher une pension, augmenter l'âge à partir duquel on a le droit de toucher une pension à taux plein quelques soient les annuités) ou on peut augmenter les devoirs (augmenter les cotisations ou augmenter le nombre d'années de cotisations). Tel est le cadre incontestable du débat.
Vient la question de la légitimité politique de l'exécutif pour conduire cette réforme, qui ne figurait pas dans le programme du candidat Sarkozy. Il faut au contraire mettre à son crédit de faire une réforme impopulaire (on le voit dans les sondages actuellement) qui prend acte d'une dégradation de la situation économique qui n'était pas prévisible en 2007. J'ajoute que le gouvernement aurait pu choisir la solution de facilité qui consistait à réformer pendant l'été, en catimini, mais qu'il a préféré que le débat ait pleinement lieu avec le travail préparatoire du Conseil d'Orientation des Retraites pour dresser un état des lieux et livrer des simulations financières incontestables, une phase de consultation des organisations syndicales et politiques, un débat plein et entier à l'Assemblée et au Sénat. Dire que cette méthode est illégitime, cela revient à dire que la démocratie représentative est illégitime, ce qui me semble très dangereux. Bien entendu, tout ne vient pas de la crise, et il est évident que la réforme est aujourd'hui nécessaire parce que la précédente réforme de 2003 était insuffisante, mais le corps social français a l'air de préférer des réformes progressives et à répétition. Ainsi, on peut d'ores et déjà affirmer que le problème des retraites ne sera pas réglé par cette réforme et qu'il faudra dans 5 ou 10 ans, remettre l'ouvrage sur le métier.
Pourquoi toucher aux bornes d'âges ?
En première approximation (qu'il conviendra de corriger par la suite), la réforme proposée par le gouvernement consiste en une réduction des droits du système de retraite, sans demander beaucoup de devoirs supplémentaires (à part pour les fonctionnaires qui vont voir leur taux de cotisation augmenter). Cette diminution de droits prend deux formes différentes : il ne sera plus possible (sauf si on a commencé à travailler avant 17 ans) de prendre sa retraite avant 62 ans et il ne sera plus possible de recevoir une retraite à taux plein sans avoir les annuités suffisantes avant 67 ans. Ces deux modifications s'appliqueront progressivement (4 mois de décalage par an à partir de juillet 2011). Avant d'entrer dans le détail, il faut comprendre l'orientation générale de cette réforme : diminuer les droits plutôt qu'augmenter les devoirs, c'est vouloir que le régime des retraites ne pèsent pas trop sur la richesse nationale produite. En gros, cette réforme permet de diminuer le coût (en point de PIB) du régime des retraites.
Deux autres réformes possibles consistent au contraire à maintenir les droits en augmentant les devoirs : l'augmentation des cotisations (ou des impôts) retenue par le parti socialiste ou l'augmentation de la durée de cotisation retenue par la CFDT. Ces deux réformes, ont pour conséquence d'augmenter le coût du régime de retraites en points de PIB (demander plus de cotisations, c'est demander qu'une plus grande part de la valeur ajoutée produite soit destinée au financement des pensions de retraite).
Pour être exact, le gouvernement a en fait choisi une réforme mixte, puisque en plus de ses deux mesures emblématiques qui limitent les droits du système, il confirme l'orientation de la loi de 2003 qui vise à augmenter la durée de cotisation. Celle-ci est passée de 40 à 41 ans pour le privé et de 37,5 à 41 pour le public, il est désormais acté qu'elle atteindra 41,5 pour tout le monde d'ici 2018. On a donc une réforme en deux temps : tout d'abord, ce qui rapprochera le régime de l'équilibre, c'est la diminution des droits (âge légal porté à 62 ans) jusqu'en 2015 environ puis ce sera l'augmentation des devoirs qui prendra le relais, étant entendu qu'avec 41,5 annuités de cotisation, presque personne ne pourra partir avant 62 ans en 2018 et donc que cette mesure ne rapportera plus grand chose. Tout cela est très clairement exposé dans le rapport du COR.
Pour certains, passe encore le passage de 60 à 62, mais pas celui de 65 à 67, c'est notamment l'opinion de François Bayrou et de Dominique de Villepin. Ils ont tort car il ne sert à rien d'augmenter la durée de cotisation si on maintient fixe l'âge à partir duquel on peut partir à taux plein sans avoir suffisamment cotiser. Si on retenait une réforme du type 62 ans – 41,5 annuités et 65 ans, alors elle rapporterait de l'argent au début mais ne rapporterait plus rien à partir de 2015 puisque l'augmentation de la durée de cotisation serait totalement neutralisée par le maintien de l'âge légal de 65 ans.
Certains s'interrogent sur la dualité du système français : pourquoi combiner durée de cotisation et âge légal ? Une autre réforme aurait pu consister à supprimer les âges légaux, les gens ne pouvant partir à la retraite qu'une fois les 41,5 annuités faites, sauf à subir une très forte décôte. J'invite chacun à réfléchir aux conséquences d'un tel système qui serait certainement socialement beaucoup plus dur, puisqu'il est très difficile pour les personnes qui ont connu de longues périodes d'inactivité d'atteindre ces 41,5 annuités, ils toucheraient donc des retraites misérables. Je pense qu'il est sain que la présence de l'âge légal permette d'amortir les décôtes du régime, afin que chacun puisse in fine bénéficier d'une retraite convenable (signe d'un système redistributif). Ne jouer que sur la durée de cotisation, en accentuant les décôtes et les surcôtes reviendrait à une très forte diminution des pensions des personnes en difficulté. Par ailleurs il faut rappeler qu'un individu qui travaille de 20 à 60 ans et qui meurt à 80 ans coûte plus cher qu'un individu qui travaille de 25 à 65 ans et qui meurt également à 80 ans, alors qu'ils ont cotisé la même période : bref, la durée de cotisation n'est pas l'alpha et l'oméga d'une système de retraite par répartition.
Une réforme plus profonde est possible, avec le système par points souvent vanté : on accumule des droits pendant sa période d'activité qui dépendent des cotisations que l'on a versé, puis quand on liquide sa retraite, on convertit ces droits en pension, en fonction de l'espérance de vie de la population, de manière à ce que le régime soit structurellement équilibré. Ce régime a l'avantage de la clarté, et de la justice entre les cotisants mais il consiste en un bouleversement du régime actuel, ce qui est techniquement très complexe. Il est bon qu'un amendement accepté au Sénat ouvre la voie vers un tel système en proposant un nouveau débat après la présidentielle, mais il reste beaucoup de travail à faire pour définir les paramètres précis de ce système : faire une grande réforme systémique dans la précipitation aurait été dangereux. Il est bon de dissocier deux questions fondamentales : comment résorber maintenant le déséquilibre financier de notre système de retraite (ce que fait la réforme du gouvernement) ? Et comment rendre notre système plus lisible à moyen terme (ce que ferait une prochaine réforme vers un système par points).
Cette réforme est-elle juste ?
Le grand reproche adressé à cette réforme est qu'elle serait injuste, cela me semble exagéré, on peut même dire que des avancées sociales (qui ont inévitablement un coût) sont présentes dans le texte du gouvernement. Je vais reprendre les critiques qui sont faites à cette réforme une par une.
« Cette réforme fait peser 75% de l'effort financier sur les seuls salariés ». Effectivement, une contribution minoritaire est demandée à la fiscalité, notamment celle du patrimoine. Mais cela est bien normal car le système de retraite bénéficie à 100% aux salariés ! Avant cette réforme, 100% de l'effort était donc porté par les seuls salariés (y compris du temps de Mitterrand) sans que cela n'émeuve personne. Je considère même que le gouvernement a eu tort d'introduire des prélèvements fiscaux supplémentaires pour financer les retraites : une réforme fiscale est sans doute nécessaire mais l'impôt n'est pas fait pour financer les retraites ou le chômage.
« En augmentant l'âge légal, cette réforme est injuste envers ceux qui ont commencé à travailler très tôt ». Tout d'abord, il est bon de rappeler que quelqu'un qui commence à travailler tôt et qui cotisera plus longtemps que 41,5 annuités touchera une surcôte lors de sa retraite et qu'il aura eu des années de revenus supplémentaires par rapport à quelqu'un qui entre tard sur le marché du travail (et il n'y a pas que les futurs riches qui sont dans ce cas loin de là). Ce serait envoyer un mauvais signal à la population que de dire que les années de formation sont un handicap pour toucher sa retraite ! Il faut également retenir que le gouvernement a étendu le mécanisme des « carrières longues », mis en place dans la réforme de 2003 et qui permet à ceux qui ont commencé à travailler à 16 ans de partir plus tôt. Désormais ceux qui ont commencé à travailler à partir de 16 ou 17 ans pourront continuer à partir à 60 ans et pas à 62 ans. Il faut noter qu'avant 2003, aucun système de ce type n'existait alors que beaucoup plus de personnes avaient commencé à travailler tôt : un ouvrier qui partait à la retraite à 60 ans en 1982 pouvait donc très bien avoir cotisé pendant 44 ans sans que cela ne semble choquer personne ! On peut à la limite soutenir que les nouveaux droits sur les carrières longues ne vont pas assez loin, mais on est forcé de reconnaître qu'ils constituent des avancées par rapport à la situation précédente.
« Cette réforme ne prend pas assez compte de la pénibilité ». La question de la pénibilité est objectivement très complexe : tous les métiers peuvent être considérés, d'une manière ou d'une autre comme pénible (pénibilité physique, intellectuelle, stress...). Or dire que tous les métiers sont pénibles revient à dire qu'aucun ne l'est. Un critère « objectif » est avancé par certains : l'espérance de vie des différents groupes sociaux, qui diffère sensiblement par exemple entre les ouvriers et les cadres. Mais comment savoir quelle part de cet écart est expliquée par les métiers exercés ? Il est difficile de contester que les cadres ont une meilleure hygiène de vie (alimentation, tabac, alcool) que les ouvriers, notamment parce qu'ils sont plus riches : est-ce au système de retraite de compenser aussi ce différentiel d'hygiène de vie ? Il me semble que non, que d'autres instruments politiques, notamment de santé publique, de conditions de travail ou de temps hebdomadaire de travail, sont plus appropriés. J'ajoute qu'un métier pourra être pénible pour un individu (qui a mal au dos par exemple) et pas pour un autre. Dans ces conditions, la seule façon de tenir compte de la pénibilité, c'est de la constater lors du départ à la retraite, à travers le taux d'incapacité retenu par le gouvernement. Bien entendu, on dira que les gens qui sont morts de l'amiante étaient souvent en bonne santé en partant en retraite, mais cette objection est rhétorique : par définition on ne connaît pas les grands problèmes de santé qui sont à venir, il est impossible d'en tenir compte avant qu'ils ne se manifestent, charge à l'Etat de les compenser par la suite.
« Si on fait partir plus tard les personnes à la retraites, les jeunes ne vont plus trouver d'emplois ». Cette vision malthusienne qui pose que la France possèderait un « stock » de travail à peu près constant est certainement la plus grande erreur économique qui est communément commise. Il faut le redire avec force : il n'y a pas de stock d'emploi donné pour un pays, qu'il ne sert à rien de le diviser le plus possible pour que tout le monde ait un emploi. Au contraire, en procédant ainsi on appauvrit le pays et que c'est en fait le travail qui appelle le travail car il génère des revenus supplémentaires. La réforme du gouvernement est en fait objectivement dans l'intérêt des jeunes puisqu'elle fait principalement contribuer les quadragénaires et les quinquagénaires !
Conclusion
J'espère avoir été suffisamment dans le détail pour convaincre que la réforme des retraites qui est en passe d'être votée par le Parlement est à la fois nécessaire, plutôt intelligente et plutôt juste. Je répète qu'il s'agit à mes yeux, de loin, de la meilleure réforme de ces dernières années, et qu'il faut donner acte à l'exécutif d'avoir eu le courage de la mener à son terme. Il faut maintenant réfléchir au moyen terme avec une transition vers un système par points qui sera plus lisible par nos concitoyens. Mais que l'on ne s'y trompe pas : le passage à un tel système ne changera pas la donnée de fond selon laquelle quand on vit plus longtemps (surtout quand c'est en bonne santé), il faut travailler plus longtemps. Une telle évolution ne me semble pas être une régression sociale puisqu'au final les gens vivront plus longtemps en retraite en partant à 62 ans en 2018 que ceux qui partaient à 60 ans en 1981 : cela mérité d'être dit !